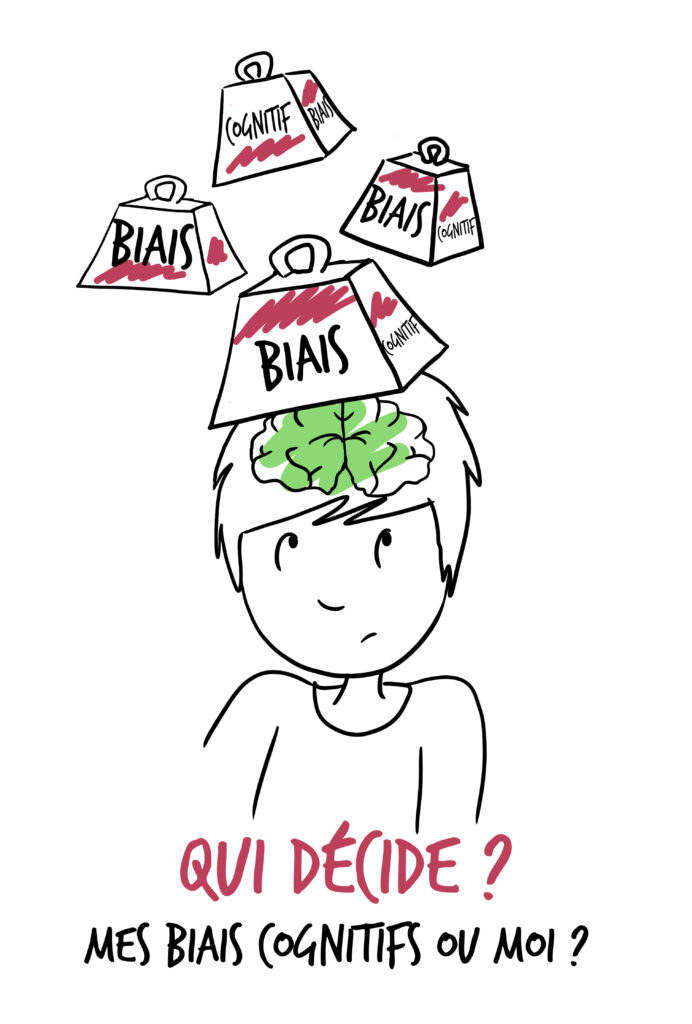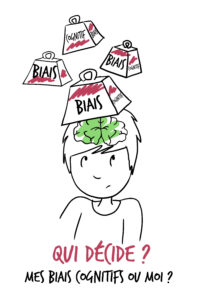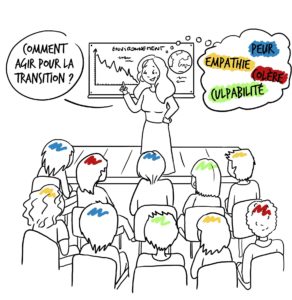Le biais de confirmation : « Il fait 20° dehors alors qu’on est en juin, c’est bien la preuve que le réchauffement climatique n’existe pas ! ». Si vous avez déjà pensé de cette manière, c’est que vous étiez très certainement dans un biais de confirmation. Ce biais consiste à ne sélectionner que les informations qui confortent notre avis déjà établi. En matière de comportements écologiques, si vous êtes climatosceptique (pas vous directement, si vous êtes en train de lire cet article, c’est que ce n’est très probablement pas le cas !), le fait de voir qu’il pleut ou qu’il fait froid en été aura tendance à vous conforter dans l’idée que le changement climatique n’existe pas.
Le biais de représentativité : « Les transports en commun, c’est vraiment pas pratique, la dernière fois, j’ai dû attendre mon bus pendant une heure parce qu’il était en retard ! ». En prononçant cette phrase, vous émettez un jugement général négatif uniquement à partir d’une mauvaise expérience personnelle, en occultant toutes les autres fois où le bus a certainement été à l’heure sans que vous ne le sachiez. C’est un raccourci mental qui consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs.
Le biais d’engagement : Lorsque vous attendiez votre bus qui avait une heure de retard en vous disant qu’il allait bientôt arriver, vous vous êtes sûrement dit que vous auriez mis deux fois moins de temps pour rentrer chez vous à pieds sans pour autant opter pour cette solution. Il s’agit ici de prendre des décisions allant dans le sens d’une décision initiale, et ce même si cette décision initiale a conduit à un échec. Ce qui se joue à ce moment, c’est que vous avez pris une décision initiale et qu’il devient très difficile de la remettre en cause au fur et à mesure que vous attendez, car cela vous mettrait face à votre mauvaise décision première.
Le biais de surconfiance ou effet Dunning-Kruger : Au travail, vous avez un nouveau collègue qui vient d’arriver dans votre service et celui-ci n’arrête pas de remettre en cause votre manière de travailler : « Pourquoi tu ne classes pas tes dossiers de cette façon ? Pourquoi tu ne réponds pas à ces mails d’abord ? ». Votre collègue se trouve ici dans un biais de surconfiance. C’est une surestimation de ses connaissances ou compétences dans un domaine, car on n’a pas conscience de ce qu’on ignore encore.
L’effet de cadrage des informations : Si je vous pose la question suivante : « Est-il important de diminuer sa consommation de viande ? », votre réponse s’orientera certainement soit vers un oui, car c’est positif pour l’environnement ou le bien-être animal ou bien vers un non, car ce serait trop coûteux pour vous et que ça aurait trop peu d’impact à l’échelle globale. En revanche, votre réponse serait sûrement bien différente si je vous demandais « Pourquoi il est important de diminuer sa consommation de viande ? ». En effet, cette seconde formulation propose un cadre davantage orienté, fermant davantage le débat concernant l’importance ou non d’adopter ce comportement. Vous êtes ainsi influencé·e par la manière dont est présentée une information.
L’erreur fondamentale d’attribution : « Celui-là, c’est vraiment un fou ! » vous êtes-vous déjà exclamé·e lorsque sur l’autoroute, vous êtes dépassé·e par une voiture roulant à plus de 150 km/h. Pourtant, comment pouvez-vous être certain·e que cette personne ne conduit pas ainsi en raison d’une urgence médicale par exemple ? Si vous-même deviez adopter ce comportement, ne le feriez-vous pas pour de bonnes raisons qui dépassent votre seule volonté ? L’erreur fondamentale d’attribution, c’est donc le fait d’attribuer des causes internes aux comportements des autres en occultant les causes externes, tout en s’attribuant à soi-même davantage de causes externes pour nos propres comportements que celles internes.
L’effet de halo : « Cette personne est vraiment très belle, elle doit certainement être brillante… ». Les études sur cet effet ont démontré qu’une personne perçue comme plus attirante, sera également perçue comme plus intelligente, plus amicale et plus drôle.3 Le fait d’être perçu·e comme plus attirant·e permet également d’accéder davantage à l’emploi que le fait d’être perçu·e comme repoussant.e.4 Pire encore, le fait d’être perçu·e comme repoussant·e est souvent associé à une perception de mauvaise santé.5 L’effet de halo consiste ainsi à juger plus positivement les caractéristiques d’une personne en raison d’un jugement préalablement positif sur une autre caractéristique de cette personne et ce, sans même avoir d’informations sur ce sujet.